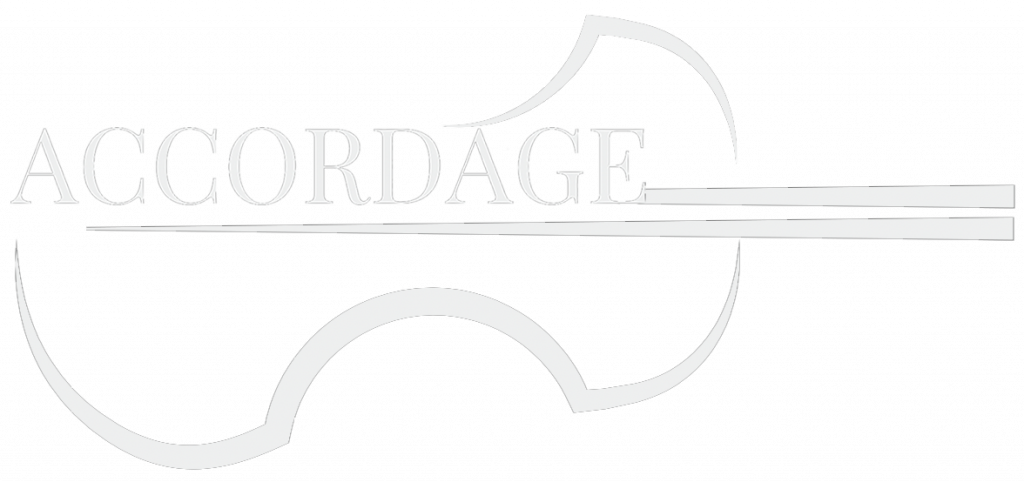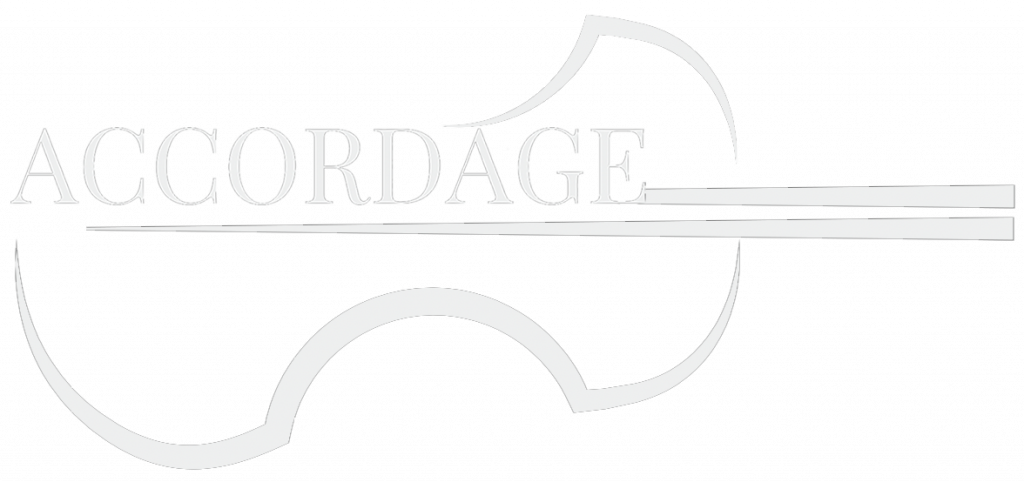L’autisme a été étudié et décrit dès le milieu du siècle dernier.
Autisme vient du préfixe « auto », qui signifie « soi-même » en grec ancien.
« Préoccupés par eux-mêmes » fut à l’époque l’appellation choisie pour définir et mettre du sens sur les comportements de certaines personnes rendues inquiétantes par le fait qu’elles semblaient éviter les relations avec les autres.
Aujourd’hui, alors que chacun a déjà entendu parler de l’autisme, l’incompréhension autour de cette pathologie alimente encore les phénomènes de comparaison, jugement et exclusion de ce qui semble trop différent de la norme.
Cela rassure les gens de penser que c’est l’autre qui est différent. Si quelqu’un se proclame juge de la différence de l’autre, il s’auto-proclame « normal », et l’autre devient responsable de sa différence. Plus concrètement, si quelqu’un me fuit, je préfère me dire qu’il n’aime pas la relation plutôt que me demander si je sens mauvais ou si je lui fais peur !
Les personnes autistes, qui ont des difficultés pour être en relation, continuent à être exclues, sous prétexte qu’elles viendraient d’une lointaine planète.
Rejetées parce qu’elles ont du mal avec les interactions sociales, équivaut à dire qu’elles n’en ont pas besoin. Ce qui revient à priver d’oxygène quelqu’un qui a du mal à respirer !
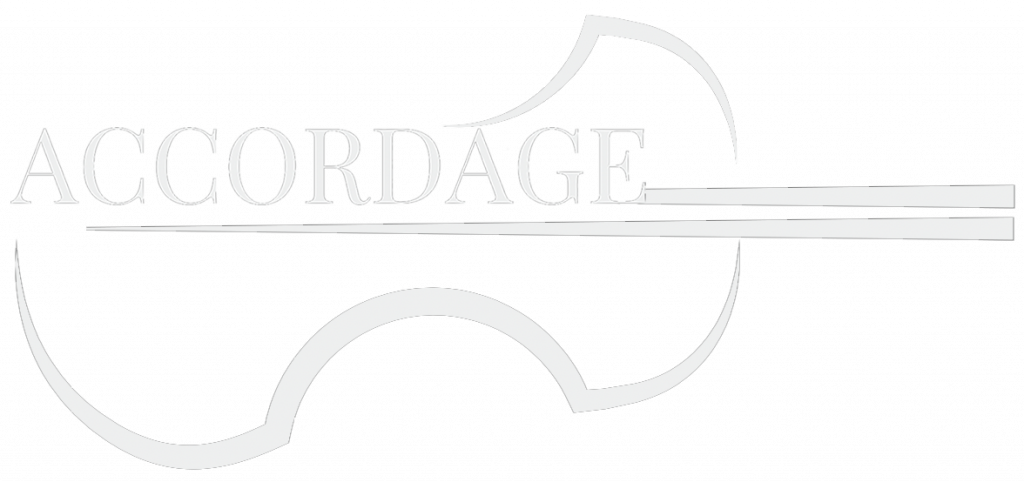
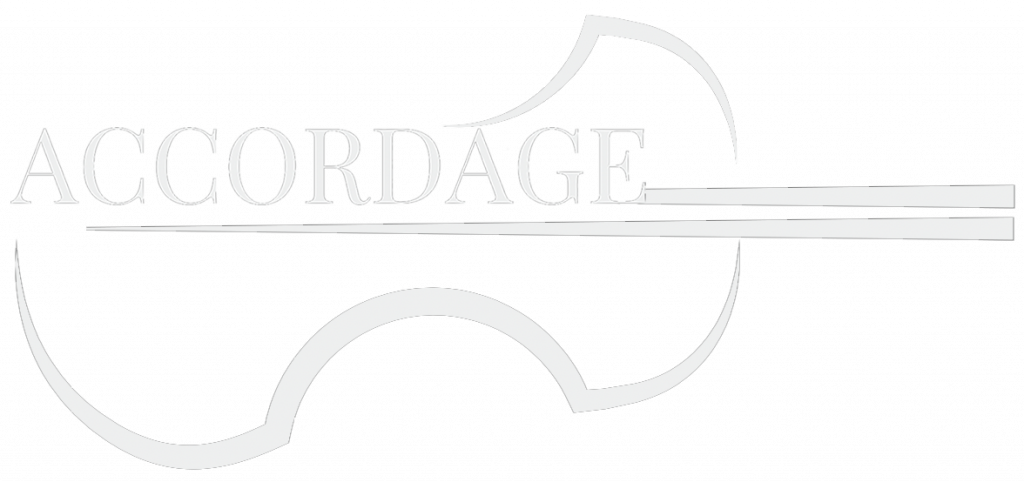
Entre deux personnes, la traduction réciproque des différences de chacun produit un début de compréhension mutuelle et ouvre à la connaissance de l’autre.
La peur et la fuite laissent la place à l’intérêt. L’exclusion et le conflit deviennent apprivoisement et rencontre.
Lorsque deux pays élaborent de quoi traduire leurs langues respectives, ils peuvent se rencontrer, se parler, et échanger sur ce qui rend leurs cultures spécifiques.
Se comprendre permet à deux personnes de se sentir plus proches l’une de l’autre, d’accepter de se rencontrer, de communiquer.
Lorsque l’on se connaît mutuellement, on a moins besoin des étiquettes pour nous résumer.